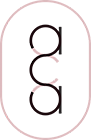Coup de scalpel sur la responsabilité médicale et son évolution
« Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie ». Par cette figure de style, Malraux mettait en exergue le coût inestimable de la vie.
Grâce aux progrès spectaculaires de la science, la médecine est devenue extrêmement invasive. La notion de risque médical est donc logiquement apparue vers le milieu du XXème siècle avec une augmentation significative dans les années 80.
Une erreur médicale ou accident médical désigne couramment toute forme d’incident ou d’accident survenant dans le domaine de la santé.
L’évolution du contentieux médical s’est d’abord manifesté d’un point de vue statistique du nombre d’instances mettant en jeu la responsabilité des médecins et des établissements de soins.
L’importance du phénomène doit cependant être mesurée et relativisée au regard du nombre total d’actes médicaux pratiqués chaque année en FRANCE. Ainsi, pour l’année 1998, on estimait le nombre de sinistres déclarés à 10 406 pour plus de 330 millions d’actes médicaux réalisés.
De surcroît, les actions en justice se traduisaient le plus souvent par un rejet de la responsabilité du médecin qui, au civil, n’était condamné que dans 1 cas sur 5 et, au pénal, dans 1 cas sur 8.
Dans ces conditions et contrairement aux craintes parfois exprimées, une « dérive à l’américaine » ne semblait pas devoir être redoutée, même si l’augmentation du contentieux était réelle et très péniblement ressentie par le corps médical.
Les causes de cette augmentation du contentieux s’expliquent par plusieurs facteurs :
- La technicité croissante de la médecine, de plus en plus invasive, qui est donc de nature à causer des dommages toujours plus importants. En effet, plus agressive à l’égard du patient, la gravité des dommages est accrue et son origine est souvent iatrogène.
Aujourd’hui, le patient supporte de moins en moins l’échec d’un acte qu’il considère, souvent à tort, comme anodin sur le fondement d’une croyance illimitée en les vertus de la science.
L’humain est passé du monde de l’être à celui de l’avoir.
- La désacralisation de la personne du médecin accentue le développement du contentieux. Le médecin n’est, en effet, plus considéré comme détenteur d’un savoir incontesté. Le malade aspire à une information accrue, devenant parfois un consommateur de soins, ce qui légitime, selon lui, la perspective d’une action en justice.
- L’évolution des règles de fond du droit de la responsabilité médicale qui a marqué la transformation de la matière avant l’adoption de la loi du 4 mars 2002. Les évolutions jurisprudentielles, tant judiciaires qu’administratives, ont en effet tendu à un durcissement des règles : extension des hypothèses de responsabilité sans faute, élargissement du contenu de l’information médicale, etc…
Cette évolution doit pourtant être nuancée au regard de l’évolution parallèle du droit commun de la responsabilité dans le sens d’une indemnisation toujours plus large et systématique des préjudices, notamment corporels.
Seul l’accident médical restait, jusqu’à la loi du 4 mars 2002, régi par un strict principe de responsabilité pour faute, moyennant toutefois une multiplication des exceptions.
La loi du 4 mars 2002 dite Loi Kouchner s’applique aux dommages causés dans le cadre d’une activité médicale réalisés au plus tôt dans les 6 mois avant sa publication, soit à compter du 5 septembre 2001.
Au titre des principes généraux, l’on distingue :
- Un régime de responsabilité pour faute à l’égard des médecins pour les dommages résultant d’un acte médical ou chirurgical sauf dans le cas de la mise en œuvre d’un produit de santé défectueux
- Un régime de responsabilité sans faute à l’égard des établissements de soins en cas de contraction d’une infection nosocomiale (article L.1142-1 du Code de la Santé Publique).
- Pour les dommages présentant un certain degré de gravité (article L.1142-1 II CSP), la loi a instauré un régime d’indemnisation au titre de la « solidarité nationale » (ONIAM) sans preuve d’une faute : aléa thérapeutique et infections nosocomiales entraînant une Incapacité Permanente Partielle supérieure à 25%.
La principale innovation de la loi du 4 mars 2002 a donc été d’admettre une indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages les plus graves causés par un accident médical et par une infection nosocomiale.
Dans les autres cas, les règles de fond de la responsabilité n’ont pas été profondément bouleversées puisque le principe d’une responsabilité fondée sur la faute demeure.
La volonté de désengorgement des juridictions n’a pour autant pas été couronnée de succès puisque, si le nombre des saisines des CRCI a nettement augmenté depuis 2003, le nombre d’actions en justice n’a corrélativement pas diminué.
Selon le rapport annuel du GAMM (Resp. nov. 2010, p.87), les « victimes qui saisissent les CRCI ne le feraient donc pas par préférence à la voie judiciaire, mais par appréhension de cette procédure comme une nouvelle opportunité plus aisée pour obtenir une indemnisation. Ces mêmes victimes auraient peut-être renoncé à agir antérieurement à l’introduction de ce nouveau dispositif ».
La loi du 4 mars 2002 n’a donc, sur ce point, rempli que partiellement ses objectifs.
Depuis le célèbre arrêt MERCIER (Civ. 20 mai 1936), il est constant que la conformité de l’acte médical s’apprécie au regard des données acquises de la science à la date des soins pratiqués.
Or, depuis quelques années, on assiste à une normalisation de ces données pour des raisons tenant à la fois à la complexité croissante des pratiques médicales, et à la fois au souci de mettre à la disposition des médecins des éléments d’information suffisamment accessibles : recommandations des bonnes pratiques par l’ANAES, références médicales opposables, conférences de consensus…
Parallèlement, on assiste à un phénomène identique en ce qui concerne la réparation des préjudices du dommage corporel, c’est-à-dire des préjudices de la victime. En effet, des inégalités ont été mises dénoncées dans le traitement des victimes par les différentes juridictions nationales présentant pourtant des incapacités identiques.
Depuis une dizaine d’années, un double phénomène s’est donc instauré : d’une part, la publicité des outils d’évaluation des préjudices corporels et, d’autre part, la fédération tant autour d’une catégorie spécifique de préjudices de masse (référentiel ONIAM, barème indicatif FIVA) qu’au travers d’une mutualisation des jurisprudences de plusieurs cours d’appel (référentiel MORNET).
Postérieurement à la loi du 4 mars 2002, il a, enfin, fallu désamorcer rapidement une crise majeure de l’assurance inhérente aux nouveaux régimes de responsabilité instaurés.
En effet, en instaurant une obligation d’assurance de responsabilité civile des professionnels de santé, la loi du 4 mars 2002 avait généré une crise auprès des assureurs : volonté de ne plus assurer le risque médical ou augmentation substantielle des primes d’assurance.
Pour répondre à cette crise, la loi du 30 décembre 2002 a été adoptée. Elle peut être résumée en trois points :
- La garantie de l’assureur est acquise lorsque la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat d’assurance, dès lors que le fait dommageable est naturellement survenu dans le cadre des activités du professionnel de santé garanties au moment de cette première réclamation,
- une reprise du passé inconnu,
- une garantie subséquente d’au moins cinq ans, portée à dix ans en cas de décès ou de cassation d’activité du médecin exerçant à titre libéral.
Le droit de la responsabilité médicale est en perpétuel mouvement. Son évolution suit celle des techniques médicales et doit s’ajuster sans cesse aux nouvelles réalités.